Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m'appesantissais,
faible et fatigué, sur maint curieux et bizarre volume de savoir oublié
- tandis que je dodelinais de la tête, somnolant presque : soudain se
fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la
porte de ma chambre - cela seul et rien de plus.
Ah! distinctement je me souviens que c'était en le glacial Décembre:
et chaque tison, mourant isolé, ouvrageait son spectre sur le sol.
Ardemment je souhaitais le jour - vainement j'avais cherché
d'emprunter à mes livres un sursis au chagrin - au chagrin de la
Lénore perdue - de la rare et rayonnante jeune fille que les anges
nomment Lénore: - de nom pour elle ici, non, jamais plus.
Et de la soie l'incertain et triste bruissement en chaque rideau
purpural me traversait - m'emplissait de fantastiques terreurs pas
senties encore : si bien que, pour clamer le battement de mon coeur,
je demeurais maintenant à répéter : «C'est quelque visiteur qui
sollicite l'entrée, à la porte de ma chambre - quelque visiteur qui
sollicite l'entrée à la porte de ma chambre; c'est cela et rien de plus.»
Mon âme se fit subitement plus forte et, n'hésitant davantage :
«Monsieur, dis-je, ou Madame, j'implore véritablement votre
pardon ; mais le fait est que je somnolais, et vous vîntes si
doucement frapper, et si faiblement vous vîntes heurter, heurter à
la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûr de vous avoir
entendu.» - Ici j'ouvris grande la porte : les ténèbres et rien de plus.
Loin dans l'ombre regardant, je me tins longtemps à douter, m'étonner
et craindre, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver encore;
mais le silence ne se rompit point et la quiétude ne donna de signe :
et le seul mot qui se dit, fut le mot chuchoté ; «Lénore!». Je le
chuchotai - et un écho murmura de retour le mot «Lénore!» -
purement cela et rien de plus.
Rentrant dans la chambre, toute l'âme en feu, j'entendis bientôt un heurt
en quelque sorte plus fort qu'auparavant. «Sûrement, dis-je, sûrement
c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons donc ce
qu'il y a et explorons ce mystère - que mon coeur se calme un moment
et explore ce mystère ; c'est le vent et rien de plus.»
Au large je poussai le volet, quand, avec maints enjouement et agitation
d'ailes, entra un majestueux corbeau des saints jours de jadis. Il ne fit
pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni n'hésita un instant : mais,
avec une mine de lord ou de lady, se percha au-dessu de la porte de
ma chambre - se percha sur un buste de Pallas, juste au-dessus de la
porte de ma chambre - se percha -siégea et rien de plus.
Alors cet oiseau d'ébène induisant ma triste imagination au sourire, par
le grave et sévère décorum de la contenance qu'il eut : «Quoique ta
crête soit chue et rase, non! dis-je, tu n'es pas pour sûr un poltron,
spectral, lugubre et ancien Corbeau, errant loin du rivage de Nuit
- dis-moi quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de Nuit?»
Le Corbeau dit : «Jamais plus!»
Je m'émerveillai fort d'entendre ce disgracieux volatile s'énoncer aussi
clairement, quoique sa réponse n'eût que peu de sens et peu
d'à-propos ; car on ne peut s'empêcher de convenir que nul homme
vivant n'eut encore l'heur de voir un oiseau au-dessus de la porte de
sa chambre - un oiseau ou toute autre bête sur le buste sculpté
au-dessus de la porte de sa chambre avec un nom tel que:
«Jamais plus!»
Mais le Corbeau, perché solitairement sur ce buste placide, parla ce
seul mot comme si mon âme, en ce
seul mot, il la répandait. Je ne proférai donc rien de
plus : il n'agita donc pas d eplume - jusqu'à ce que je
fis à peine davantage que marmotter « D'autres amis
déjà ont pris leur vol - demain il me laissera comme
mes Espérances déjà ont pris leur vol.» Alors l'oiseau
dit : «Jamais plus!»
Tressaillant au calme rompu par une réplique si bien
parlée : «Sans doute, dis-je, ce qu'ilprofère est tout
son fond et son bagage, pris à quelque malheureux
maître que l'impitoyable Désastre suivit de près et
de très près, suivit jusqu'à ce que ses chansons
comportassent un unique refrain ; jusqu'à ce que les
chants funèbres de son Espérance comportassent le
mélancolique refrain de «Jamais - jamais plus!»
Le Corbeau induisant toute ma triste âme encore au
sourire, je roulai soudain un siège à coussins en
face de l'oiseau, et du buste, et de la porte ; et
m'enfonçant dans le velours, je me pris à enchaîner
songerie à songerie, pensant à ce que cet augural
oiseau de jadis - à ce que ce sombre, disgracieux,
sinistre, maigre et augural oiseau de jadis
signifiait en croassant: «Jamais plus»
Cela, je m'assis occupé à le conjecturer, mais
n'adressant pas une syllabe à l'oiseau dont les yeux de
feu brûlaient, maintenant, au fond de mon sein; cela
et plus encore, je m'assis pour le deviner, ma tête
reposant à l'aise sur la housse de velours des coussins
que dévorait la lumière de la lampe, housse violette de
velours qu'Elle ne pressera plus, ah! jamais plus.
L'air, me sembla-t-il, devint alors plus dense, parfumé
selon un encensoir invisible balancé par les Séraphins
dont le pied, dans sa chute, tintait sur l'étoffe du
parquet. «Misérable! m'écriai-je, ton Dieu t'a prêté - il
t'a envoyé par ses anges le répit - le répit et le népenthès
dans ta mémoire de Lénore! Bois! oh! bois ce bon
népenthès et oublie cette Lénore perdue!» Le Corbeau
dit: «Jamais plus!»
«Prophète, dis-je, être de malheur! prophète, oui, oiseau
ou démon! Que si le Tentateur t'envoya ou la tempête
t'échoua vers ces bords, désolé et encore tout
indompté, vers cette déserte terre enchantée - vers ce
logis par l'horreur hanté : dis-moi, véritablement, je
t'implore! y a-t-il du baume en Judée? - dis-moi, je
t'implore.» Le Corbeau dit: «Jamais plus!»
«Prophète, dis-je, être de malheur! prophète, oui, oiseau
ou démon! Par les cieux sur nous épars, - et le Dieu que
nous adorons tous deux - dis à cette âme de chagrin
chargée si, dans le distant Eden, elle doit embrasser
une jeune fille sanctifiée que les anges nomment Lénore
- embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les
anges nomment Lénore.» Le Corbeau dit: «Jamais plus!»
«Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau
ou malin esprit», hurlai-je en me dressant. «Recule en
la tempête et le rivage plutonien de Nuit! Ne laisse pas
une plume noire ici comme un gage du mensonge qu'a
proféré ton âme. Laisse inviolé mon abandon! quitte le
buste au-dessus de ma porte! ôte ton bec de mon coeur
et jette ta forme loin de ma porte!» Le Corbeau dit:
«Jamais plus!»
Et le Corbeau, sans voleter, siège encore - siège encore
sur le buste pallide de Pallas, juste au-dessus de la porte
de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des
yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe
ruisselant sur lui,projette son ombre à terre; et mon âme,
de cette ombre qui gît flottante à terre, ne s'élèvera
- jamais plus!
Traduit par Stéphane Mallarmé.
Pour ceux qui voudraient la version originale en anglais ou la traduction de Baudelaire du même poème, rendez-vous là :



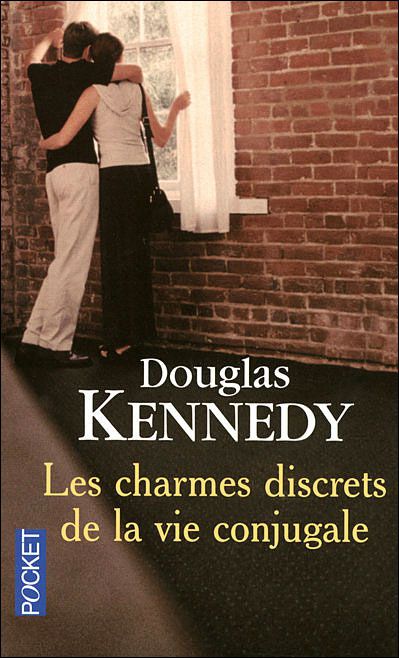




 Que pensez-vous de cette conception de la poésie qui est celle de Léo Ferré ?
Que pensez-vous de cette conception de la poésie qui est celle de Léo Ferré ? 






